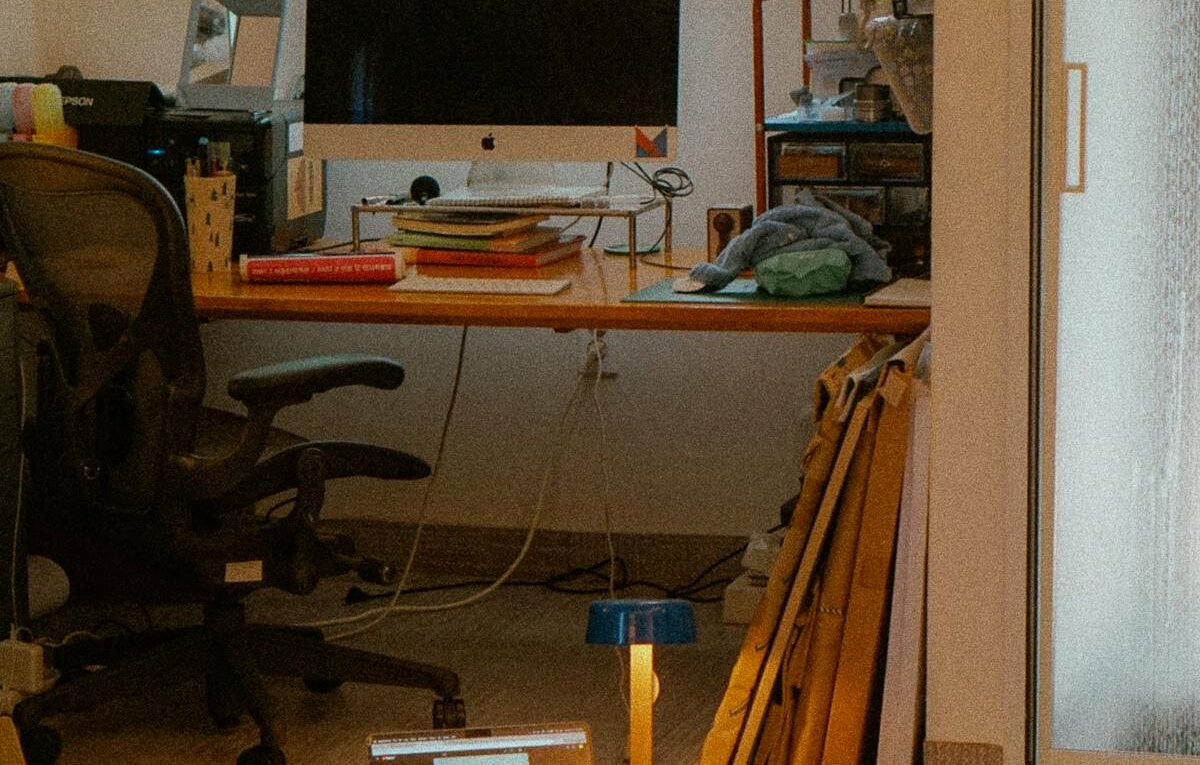Santé : une réforme des études envisagée pour la rentrée 2026
Un système d’accès aux études de santé sous le feu des critiques
Un bilan mitigé pour la réforme de 2020
Depuis sa mise en œuvre, la réforme de 2020 visant à transformer l’accès aux filières de santé suscite des avis partagés. Si certains objectifs, comme l’augmentation du nombre de places disponibles, ont été atteints, d’autres points restent problématiques. Le ministre Philippe Baptiste a récemment souligné des avancées notables, notamment une hausse significative des admissions de néo-bacheliers et une baisse des redoublements en première année. Cependant, des disparités entre établissements et des critiques sur la lisibilité du système continuent de poser question.
Les défis d’une organisation encore perfectible
La diversité des pratiques entre universités est perçue comme un frein à une meilleure compréhension du système. Les modalités de sélection, les critères d’évaluation ou encore les épreuves orales varient fortement d’un établissement à un autre, rendant l’expérience des candidats inégale. De plus, la voie LAS (Licences Accès Santé), censée offrir une alternative au PASS (Parcours Spécifique Accès Santé), peine à s’imposer comme une solution équivalente. Le PASS reste majoritaire et crée une hiérarchie perçue comme injuste par certains.
- Hétérogénéité des critères d’admission
- Manque de transparence sur les algorithmes de sélection
- Insuffisance des admissions via la voie LAS
Vers une évolution du modèle d’accès
Un appel à la simplification et à l’harmonisation
Pour répondre aux limites actuelles, plusieurs acteurs plaident pour une refonte du système. Le ministre de l’Enseignement supérieur défend l’idée d’un modèle unique avec des parcours diversifiés, tout en excluant un retour à l’ancien système de la PACES. La suppression du numerus clausus, effective depuis 2020, reste un acquis jugé positif, mais elle nécessite d’être pleinement concrétisée pour éviter de reproduire les blocages du passé.
Des pistes pour éviter l’exode des étudiants
Un autre enjeu majeur concerne les départs d’étudiants français vers l’étranger pour poursuivre leurs études de santé. Plusieurs pays, comme la Roumanie ou le Maroc, attirent ces jeunes par des conditions d’accès et de formation plus souples. Ce phénomène soulève des inquiétudes sur la souveraineté de la formation en santé en France, notamment dans des professions comme la médecine dentaire, où plus de la moitié des praticiens diplômés ont étudié hors du territoire national.
- Encourager les parcours nationaux pour limiter les départs à l’étranger
- Valoriser les formations locales par des stages et des antennes délocalisées
- Réduire les inégalités territoriales dans l’accès aux études
Une réponse aux besoins des territoires
Former pour répondre à la pénurie de professionnels
La réforme doit également s’adapter aux réalités territoriales. La France fait face à une pénurie de médecins et autres professionnels de santé, accentuée par le vieillissement de la population et une évolution des pratiques de travail. Former plus de médecins et encourager leur installation dans les zones sous-dotées figurent parmi les priorités gouvernementales. Les campus connectés et les premières années délocalisées sont des pistes explorées pour favoriser une meilleure répartition des futurs professionnels.
Encourager l’ancrage local dès les premières années
Des études montrent que les jeunes issus de zones rurales sont plus enclins à exercer dans ces mêmes territoires. En conséquence, le développement de formations accessibles localement pourrait constituer une solution pour pallier le manque de professionnels dans certaines régions. Cette approche s’accompagne de propositions visant à élargir les opportunités de stages en dehors des hôpitaux traditionnels, pour diversifier les expériences dès le début du cursus.
- Développer des antennes locales pour les premières années
- Renforcer les stages dans des environnements diversifiés
- Impliquer les territoires dans la formation des futurs soignants
Des réformes à court et moyen termes
Un calendrier chargé pour 2025
Alors que les débats se poursuivent, des propositions concrètes sont attendues dès le premier semestre 2025. Le groupe de travail du Sénat, en lien avec les ministères concernés, devrait apporter des recommandations visant à améliorer le système actuel. Parmi les sujets en discussion figurent la limitation des double-parcours, la rénovation du numerus apertus et une concertation élargie avec l’ensemble des parties prenantes.
Un équilibre à trouver
Si les réformes entreprises depuis 2020 ont permis certaines avancées, elles n’ont pas encore répondu à toutes les attentes. Le défi consiste désormais à concilier la diversification des parcours, la simplification des modalités d’accès et l’augmentation des capacités d’accueil, tout en tenant compte des réalités territoriales et des besoins croissants de la population. Les mois à venir seront déterminants pour définir l’avenir des études de santé en France.