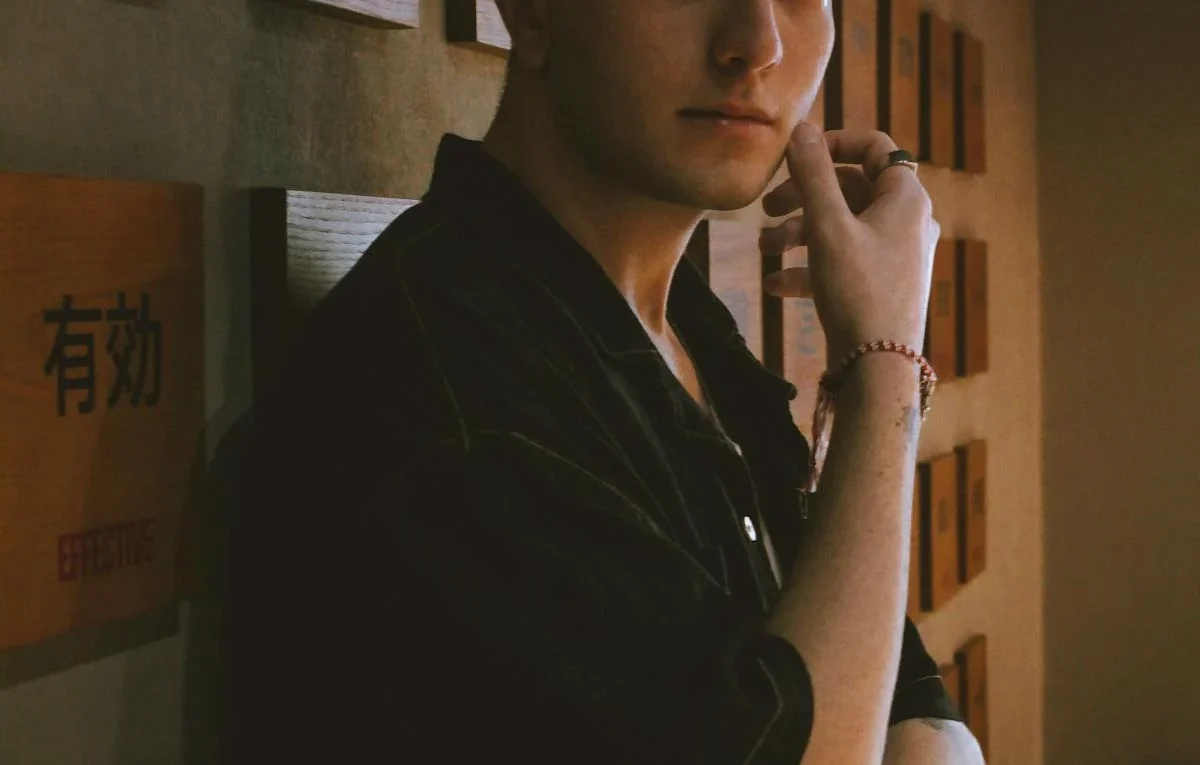Terminale SVT : explorez la diversité fascinante du vivant
Les mécanismes favorisant la diversité génétique chez les bactéries
Transfert de matériel génétique entre cellules bactériennes vivantes
Certaines bactéries possèdent la capacité d’échanger des fragments d’ADN via un contact direct entre une cellule donneuse et une cellule receveuse. Ce processus repose sur un élément spécifique situé sur un plasmide, conférant aux bactéries donneuses la faculté de partager une information génétique particulière. La connexion entre les deux cellules s’établit grâce à des structures spécialisées, facilitant ainsi le transfert. Une fois ce matériel génétique acquis, la cellule initialement receveuse peut à son tour devenir donneuse et poursuivre la transmission de ces informations.
Les bactériophages et leur rôle dans le transfert génétique
Une autre voie d’échange génétique entre bactéries implique des virus spécifiques appelés bactériophages. Ces derniers peuvent insérer leur matériel génétique dans le chromosome bactérien, devenant ainsi une partie intégrante du génome de la bactérie. Dans certaines circonstances, ce matériel viral est libéré avec des fragments d’ADN bactérien, qui peuvent ensuite être transférés à une autre cellule lors d’une nouvelle infection. Ce mécanisme, connu sous le nom de transduction, contribue à l’introduction de variations génétiques au sein des populations bactériennes.
Incorporation d’ADN libre par des cellules compétentes
Certaines bactéries ont la capacité d’intégrer de l’ADN libre provenant de cellules mortes présentes dans leur environnement. Ce processus nécessite que la cellule receveuse soit dans un état particulier, appelé compétence. L’ADN étranger ainsi absorbé peut s’intégrer au génome du receveur si une similarité entre les séquences est détectée. Ce type de recombinaison génétique joue un rôle clé dans l’adaptation et la diversification des bactéries.
Applications des transferts horizontaux en biotechnologie
Productions médicales et agroalimentaires
Ces mécanismes naturels sont exploités par les chercheurs pour des applications variées. Par exemple, en santé humaine, des bactéries modifiées génétiquement sont utilisées pour produire de l’insuline de manière économique et en grande quantité. Dans le domaine agricole, des bactéries spécifiques servent à insérer des gènes d’intérêt dans des plantes, permettant ainsi de concevoir de nouvelles variétés végétales présentant des caractéristiques avantageuses, telles que la résistance aux maladies ou des rendements améliorés.
Procédés génétiques et innovations technologiques
Les outils d’ingénierie génétique reposent fréquemment sur des transferts horizontaux. Une bactérie couramment utilisée, *Agrobacterium tumefaciens*, est capable de transmettre de l’ADN dans les cellules végétales. En modifiant cette bactérie pour y intégrer des gènes utiles, les chercheurs parviennent à améliorer les caractéristiques des cultures, tout en éliminant les effets négatifs liés à la virulence naturelle de cette bactérie.
Impact des transferts horizontaux sur l’évolution
Des réseaux phylogénétiques pour mieux comprendre l’histoire du vivant
L’analyse des relations génétiques entre les espèces révèle parfois des similitudes qui ne s’expliquent pas par une transmission directe de génération en génération. Ces ressemblances peuvent être la conséquence de transferts horizontaux de gènes, brouillant ainsi les schémas classiques de filiation. Pour mieux représenter ces phénomènes, les scientifiques construisent des réseaux phylogénétiques, plus adaptés que les arbres traditionnels pour illustrer l’évolution par fusion ou échange génétique.
Les virus, moteurs de l’évolution
Certains virus, comme les rétrovirus, ont la capacité d’insérer une partie de leur génome dans celui des organismes qu’ils infectent. Ces insertions peuvent parfois être transmises aux générations suivantes, contribuant à l’émergence de nouvelles séquences génétiques. Bien que la plupart de ces séquences soient inactives, certaines produisent des protéines fonctionnelles, jouant un rôle dans l’évolution des espèces. L’étude de ces mécanismes éclaire également des événements majeurs de l’histoire du vivant, tels que l’apparition des mitochondries et des chloroplastes, soutenant ainsi la théorie endosymbiotique.